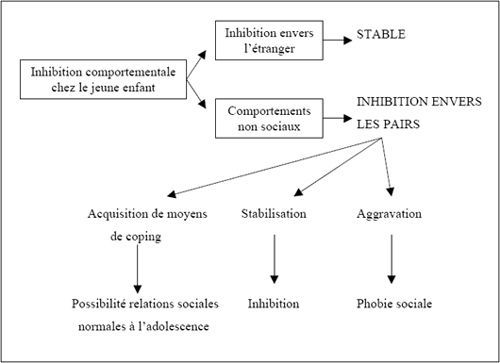Ayant loupé le dernier rendez-vous chez le psy, j'ai eu amplement le temps de réfléchir à mes épisodes dépressifs.
En fin de compte, j'ai réalisé que ces épisodes étaient liés au jugement des autres.
Le premier l'était clairement dans mon esprit. J'étais étudiante et avais une enseignante que me harcelait moralement [edit du 17 mai 2012 : avec le recul, il s'avère que cette enseignante est une perverse-narcissique]. Elle me disait à longueur de journées que je n'arriverai jamais à avoir mon diplôme, que j'étais bien trop nulle pour cela. J'ai failli mettre fin à mes études à cause d'elle. J'ai tenu bon grâce à la psychologue de la médecine préventive.
Le deuxième épisode correspond à une période où mon avenir professionnel se retrouvait fortement compromis sous la forme sous laquelle je l'envisageais. Il y avait une guerre entre deux groupes dans la structure dans laquelle je travaillais (et je travaille encore). Des gens de l'autre groupe faisaient pression sur moi. Je ne l'ai pas supporté. C'est depuis ce moment-là que j'ai consulté pour la première fois la psy que je consulte toujours, je suis sous anti-dépresseurs depuis lors.
Je ne cernais pas très bien le rapport entre ma peur du jugement et cet épisode là. Et puis j'ai compris que la fac, dans laquelle je travaille par choix depuis maintenant 10 ans, correspond à un choix de carrière, un choix de vie. J'avais la possibilité de travailler dans le privé, j'ai préféré le public, quitte à gagner beaucoup moins.
D'autre part, depuis toujours, je me suis réfugiée dans la scolarité. Étant naturellement bonne élève, j'ai eu cette chance, j'avais des "facilités" comme dit ma maman, j'avais trouvé un domaine où je ne craignais pas le jugement, puisque cela marchait pour moi. J'allais de réussite en réussite. Ma scolarité a été un succès, sans être extra-ordinaire, je n'étais pas un génie, juste une "bonne élève". Je me suis investie là-dedans, complètement. Cela me faisais un bon prétexte pour ne pas rechercher à avoir une vie sociale. J'étudiais, je n'avais pas de temps pour le reste. Mes parents ont toujours valorisé cet aspect chez moi. Avoir des enfants qui réussissent à l'école a toujours été une fierté pour eux qui ont été contraints de s'arrêter au certificat d'études. Avoir des enfants qui réussissent socialement grâce à l'école est, je pense, tout ce qu'ils ont pu espérer de mieux pour mes frères et moi. J'ai donc toujours, depuis l'enfance, passé ma vie dans les livres d'école. C'était "mon truc", ce que j'aimais faire. C'était là que je réussissais le mieux et c'était là que je n'avais pas à craindre le jugement des autres, des professeurs, puisque cela marchait.
Vers la fin de mes études secondaires, j'étais terrorisée à l'idée de partir travailler dans le privé. Tous ces gens à affronter au quotidien, alors que j'avais une possibilité de rester à la fac, domaine où je me sentais chez moi. J'ai donc décidé de prolonger mes études et de tout faire pour travailler à la fac. Cela a fonctionné, comme d'habitude, je n'entreprends que des choses dont je me doute que cela va fonctionner, et puis je me connais bien dans le domaine des études et des examens, je connais mes capacités. J'ai donc intégré la fac.
Et puis... Et puis arriva une ÉNORME désillusion. La fac était devenue comme dans le privé, du moins comme l'idée que je me faisais du privé. Des conflits de personnalités, des gens à affronter au quotidien, son steak à défendre plus que de raison. Et surtout, l'incertitude de pouvoir y rester. D'une part parce que l'équipe dans laquelle j'étais, et je suis toujours, était mise en danger; d'autre part parce que cette ambiance ne me convenais pas. Mais je ne pouvais me résoudre à quitter la fac pour partir dans le privé que j'avais toujours fui. Je me retrouvais coincée. Hopeless and helpeless, comme disent les anglophones. Sans espoir et sans issue. D'autant que je m'étais investie à fond dans ce domaine, je n'avais rien d'autre à quoi me raccrocher. Les gens qui ne misent pas tout sur leur travail peuvent se raccrocher à leur famille, leurs amis, leur hobby pour passer un cap difficile. Moi je le vivais à 100%. Rien d'autre à quoi me raccrocher. D'où crise sérieuse. Dépression. Tristesse, pleurs. Beaucoup de pleurs, tout le temps. Ma psy m'a beaucoup aidée. Grâce à elle, et aux anti-dépresseurs, j'ai surmonté la crise, j'ai repris confiance et j'ai lutté. La crise à la fac a fini par s'apaiser. La guerre entre les deux camps est redevenue une guerre froide, beaucoup plus supportable. Les gens de mon équipe ont reconnu avec gratitude mon attitude vis à vis d'eux. Je n'avais pas cédé à la pression faite par l'autre groupe, j'avais tenu bon. Je n'avais pas non plus quitté le navire. J'étais aux anges, on me remerciait d'être restée, je recevais un jugement positif. OUF.
Depuis, j'ai progressé dans mon parcours à la fac. J'ai travaillé encore et encore, en laissant de côté ma vie sociale, comme toujours. Il y a 3 ans, j'ai passé un concours pour être titularisée. Je n'ai pas eu ce concours. Drame. Rechute. J'ai mis plusieurs mois à reprendre confiance et goût à ce que je faisais. Je me suis remise au travail et j'ai repassé le concours l'année d'après. Que je n'ai pas eu à nouveau. Nouvelle grosse crise. Plus longue cette fois. Elle m'a laissé le sentiment de ne pas avoir vraiment réussi à en sortir.
Parallèlement, je me suis stabilisée sentimentalement. J'ai rencontré mon compagnon un peu avant le premier concours. Ma rencontre avec lui s'augurait être une rencontre pas tellement différente de celles que je faisais auparavant. Pas forcément LA rencontre. Et puis les évènements de sa vie et de la mienne ont fait que nous sommes toujours unis. Il a une personnalité à l'opposé de la mienne. Il a une mauvaise estime de soi mais une grande affirmation de soi. Dans mon cas, c'est le contraire. Cette opposition dans nos mode de fonctionnement provoque régulièrement des étincelles, mais il m'aide énormément. Il n'a pas toujours la patience que j'attendrais de lui, mais il est à l'origine de ma thérapie. Grâce à lui, j'ai pris conscience de mes difficultés. Même si c'est extrêmement difficile à vivre par moments, c'est grâce à lui que j'avance. Il me mène la vie dure. Il pense que cela me fait avancer. Souvent, j'aimerais avoir affaire à quelqu'un de moins exigeant. Cela sera tellement plus facile à vivre. Bref, il m'aide.
La vie à ses côtés est difficile car il me dit ce qu'il pense et lorsqu'il s'agit de choses négatives, cela provoque systématiquement une crise d'angoisse. C'est pour cela que parfois je me dis que je préfèrerais avoir quelqu'un de moins exigeant à mes côtés.
D'autant que j'ai honte de faire des crises d'angoisse pour des choses anodines qu'il m'a dites. Depuis que je connais mieux mon fonctionnement, j'ai compris ce qui provoque mes crises d'angoisse. Il a du mal à supporter mon inhibition sociale, ma peur des autres, ma peur de lui, aussi. Je sais que quand il commence à me dire quelque chose de négatif à ce sujet, je vais avoir une crise d'angoisse. Et comme j'ai peur de ces crises d'angoisse, j'ai tendance à éviter d'avoir à entendre des choses négatives. Mais cet évitement ne va pas dans le sens qu'il attend. Au lieu de modifier mon comportement dans un sens qui me ferai progresser et qui ferait qu'il n'aurait pas à me le reprocher, je fuis. Je n'ai pas encore la force de modifier tout cela seule. Ma thérapie va m'y aider. Je sais que tout ne changera pas chez moi, et je l'espère bien. Je n'ai pas l'intention de me formater. Simplement, je pense qu'à l'issue de la thérapie, je serai plus à l'aise pour m'imposer. C'est ce qu'il attend. Et ce que je désire améliorer.
Mon psy m'a dit, à l'issue de la première séance, "vous verrez comme ce sera bien quand vous serez guérie". Vivement que cela arrive.